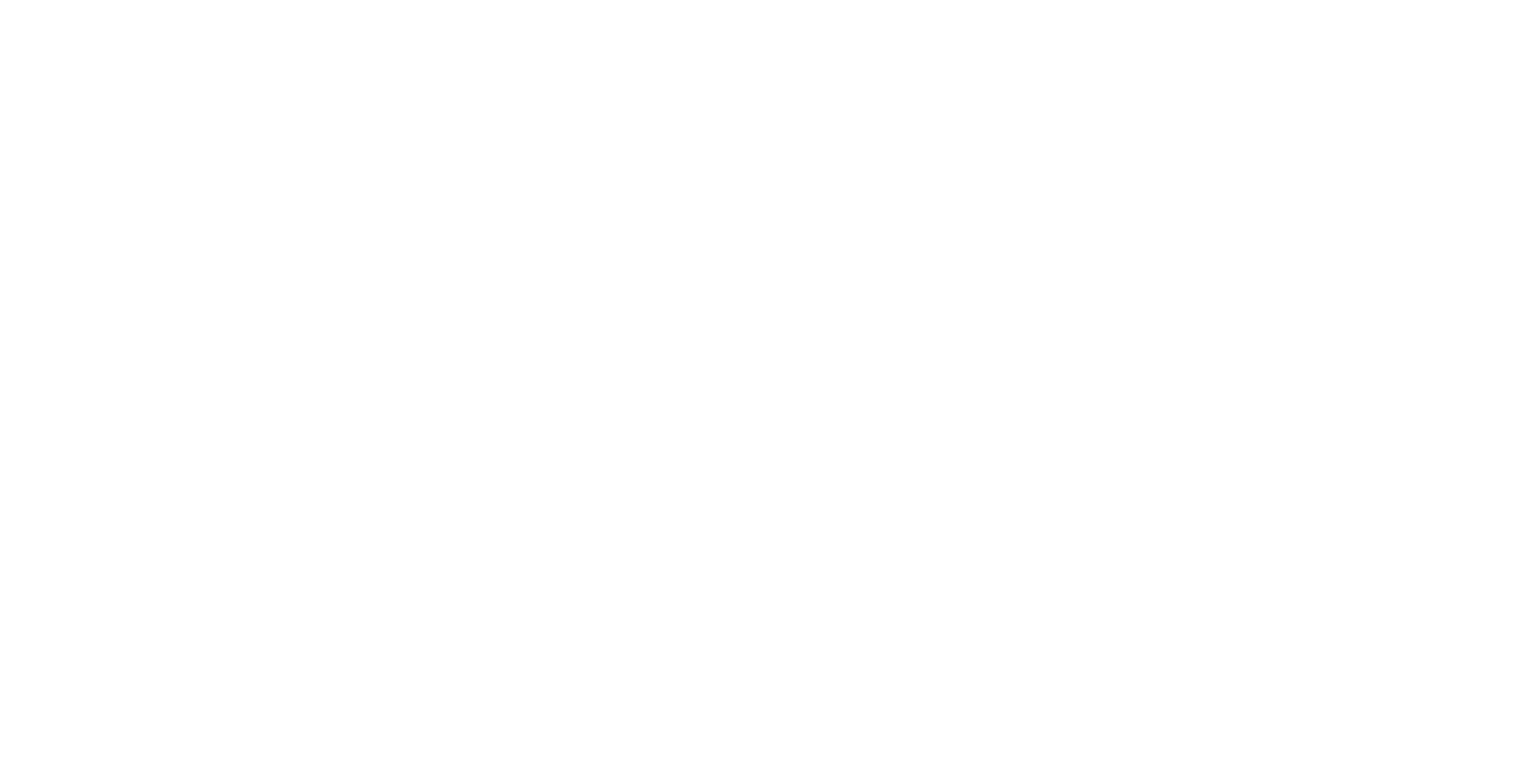Dans un cadre professionnel où la mobilité est croissante, les déplacements pour le travail représentent un enjeu majeur de risque professionnel et de risques routiers. Chaque année, des accidents routiers impliquant des salariés en risque trajet ou en risque mission entraînent des conséquences humaines, économiques et sociales lourdes. Pour une agence d’emploi, informer, sensibiliser et accompagner entreprises clientes et candidats est essentiel pour réduire ces risques professionnels liés aux déplacements.
1. Spécificités des déplacements professionnels
1.1. Trajet domicile-travail vs mission professionnelle
- Trajet domicile-travail : relie le domicile habituel au lieu de travail, incluant la pause de restauration habituelle entre deux sessions.
- Mission professionnelle : tout déplacement hors du trajet habituel (visite client, rendez-vous, transfert). Chaque emploi induit un risque mission, différent du risque trajet.
Cette distinction influe sur la responsabilité de l’employeur et sur la prise en charge des frais (indemnités kilométriques, repas, hébergement).
1.2. Enjeux chiffrés
- D’après l’INRS, les accidents de la route représentent 21 % des cas. Dans le secteur tertiaire, ils atteignent 45 %.
- Chaque année, plusieurs centaines de personnes décèdent dans des accidents routiers liés au travail et des milliers sont victimes d’un accident de trajet ou d’un accident de mission, avec des coûts directs (indemnisations, arrêts de travail) et indirects (perte de productivité, impact réputationnel).
2. Cadre législatif et obligations
2.1. Obligation de sécurité de l’employeur
Selon l’Article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit garantir la sécurité et protéger la santé mentale et physique des salariés, incluant les missions et, dans certains cas, les trajets.
2.2. Évaluation des risques et plan de prévention
Le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) doit recenser l’ensemble des risques professionnels, notamment :
- Risques chimiques (produits dangereux manipulés lors de la mission).
- Risques particuliers (travail en hauteur, manutention, expositions spécifiques).
- Risques routiers : accidents de voiture, deux-roues. Ces risques prioritaires nécessitent des plans de prévention incluant :
- Formation et sensibilisation : Code de la route adapté, conduite éco-responsable, gestion de la fatigue.
- Organisation de la mobilité : optimisation des itinéraires, covoiturage, transports en commun.
- Entretien régulier des véhicules : contrôle technique, vérification des pneus, freins, éclairages.
- Équipements de protection pour deux-roues : casque, gants, gilet haute visibilité.
2.3. Assurance et couverture des salariés
L’agence doit s’assurer que le contrat d’assurance couvre :
- Les accidents de trajet (domicile-travail).
- Les accidents survenus en mission (visite client, transport).
Les intérimaires bénéficient ainsi d’une prise en charge des frais médicaux et d’indemnités en cas d’incapacité, selon la législation sur les accidents du travail.
3. Facteurs de risque
3.1. Comportements à risque
- Excès de vitesse : diminue le temps de réaction et aggrave la gravité des collisions.
- Distraction au volant : téléphone, GPS, repas pris sur le pouce multiplient le risque d’accident de trajet et d’accident de mission.
- Fatigue et somnolence : conséquence de longues tournées ou missions de nuit.
- Conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants : accentue le danger.

3.2. Conditions météo et environnementales
- Pluie, brouillard, neige, verglas : augmentent les distances de freinage et réduisent la visibilité.
- Routes rurales et chantiers : absence de marquage, revêtement dégradé.
- Circulation dense : heures de pointe, stress, embouteillages.
3.3. Véhicule inadapté ou mal entretenu
- Véhicule ancien ou mal entretenu (pneus usés, freins défaillants) multiplie le risque routier.
- L’absence de contrôle technique à jour accroît la probabilité d’un sinistre.
4. Bonnes pratiques pour intérimaires et salariés
4.1. Sensibilisation préalable
L’agence intègre un module obligatoire avant chaque mission comportant du déplacement :
- Rappels du Code de la route en contexte professionnel (interdiction de téléphone en mains libres, port de la ceinture).
- Choix du mode de transport : comparaison sécurité/coût (voiture vs train, covoiturage, transports en commun).
4.2. Organisation du planning et limitation de la fatigue
- Aménagement des horaires : éviter missions tardives ou en fin de journée sans pause.
- Respect des temps de conduite :
- Non professionnels : pas plus de 4h30 sans pause de 45 minutes.
- Professionnels : maximum 9h de conduite par jour, 56h par semaine, repos quotidien de 11h.
- Encouragement au covoiturage : réduit la charge mentale et la consommation de carburant.
4.3. Vérification préalable du véhicule
Avant chaque mission, le salarié doit vérifier :
- Pneus : pression et usure.
- Niveaux : huile, liquide de frein, liquide de refroidissement.
- Feux : clignotants, feux de croisement, feux stop.
- Freins et suspension : pas de bruits anormaux.
Tout dysfonctionnement doit être signalé pour éviter un accident de trajet domicile-travail ou en mission.
5. Rôle de l’employeur client et de l’agence d’emploi
5.1. Collaboration pour définir la mobilité
L’agence, en tant qu’intermédiaire, s’assure que le client définit clairement :
- Nature des déplacements : véhicule de fonction, véhicule de l’entreprise ou véhicule personnel indemnisé.
- Modalités d’indemnisation : barème kilométrique, frais de repas, hébergement.
- Équipements et formations nécessaires : casques pour deux-roues, gilets réfléchissants, kits de sécurité, formations spécifiques.
5.2. Suivi et indicateurs de performance
L’agence propose un suivi régulier des indicateurs clés :
- Nombre d’accidents routiers, qu’il s’agisse d’accidents de trajet ou d’accidents de mission, sur une période définie.
- Taux d’absentéisme lié à ces sinistres, avec estimation des coûts financiers.
- Taux de participation aux sessions de sensibilisation à la sécurité routière.
Ces indicateurs permettent d’ajuster les actions de prévention et d’en évaluer l’efficacité.
5.3. Communication proactive
- Newsletters et bulletins internes : articles sur la sécurité routière, risques psychosociaux, risques chimiques, retours d’expérience.
- Affichages dans les locaux de l’agence et de l’entreprise cliente (limitation de vitesse, distance de sécurité, angles morts).
- Campagnes ciblées lors des périodes à risque (rentrée scolaire, fêtes, vacances) pour rappeler l’importance d’adapter sa conduite aux conditions.
6. Sensibilisation continue et formation
6.1. Modules e-learning et ateliers pratiques
- E-learning : modules interactifs sur la gestion de la fatigue, la conduite éco-responsable, la conduite en conditions extrêmes, la conduite de deux-roues.
- Ateliers pratiques : simulateurs de freinage d’urgence, parcours en réalité virtuelle pour prendre conscience des angles morts, formation à l’usage du défibrillateur en cas d’urgence.
6.2. Formation spécifique pour chauffeurs professionnels
- Formation Continue Obligatoire à la Sécurité (FCOS) : pour chauffeurs-livreurs et VTC, mise à jour du permis poids lourds, gestion du stress, vigilance sur longues distances.
- Sensibilisation aux risques psychosociaux : un conducteur stressé ou en situation de mal-être présente un risque accru d’erreur.
7. Bénéfices de la prévention
7.1. Réduction des coûts
- Diminution du nombre de sinistres : baisse des primes d’assurance, économies sur les indemnisations.
- Réduction de l’absentéisme : un salarié en bonne santé, moins exposé aux risques routiers, est plus présent et productif.
- Amélioration de la productivité : la sérénité liée à des déplacements sécurisés favorise la concentration.
7.2. Valorisation de l’agence et de la marque employeur
- Offre différenciante : axée sur la prévention des risques prioritaires, l’agence propose une offre complète (formation, audit, suivi).
- Attractivité pour les candidats : les intérimaires et salariés sont rassurés de rejoindre une structure soucieuse de leur sécurité.
- Image responsable des entreprises clientes : elles valorisent leur engagement RSE et leur politique de prévention.
Conclusion
Les déplacements professionnels, qu’il s’agisse du risque trajet ou du risque mission, exposent les salariés à des accidents routiers graves. Pour une agence d’emploi, la prévention devient stratégique : sensibiliser, former et accompagner tant les intérimaires que les entreprises clientes permet de réduire significativement ces risques professionnels, de diminuer les coûts associés et de renforcer la responsabilité sociale. En combinant bonnes pratiques, innovations et collaboration, il est possible d’instaurer une culture de sécurité routière durable, bénéfique à tous.
FAQ
Q : Quels frais sont pris en charge pour un intérimaire en déplacement professionnel ?
R : L’agence indemnise les frais kilométriques selon le barème officiel, ainsi que les frais de repas et d’hébergement si la mission l’exige. Ces modalités sont précisées avant la signature du contrat de mission, conformément à la convention collective de l’entreprise cliente.
Q : Comment déclarer un accident de trajet ou de mission ?
R : Dès l’accident, l’intérimaire informe immédiatement l’agence et l’entreprise utilisatrice En cas d’implication d’un tiers, un constat amiable peut être établi. La déclaration à la Sécurité sociale doit se faire sous 48 heures via le formulaire Cerfa n° 14463*02. L’employeur (l’agence d’emploi) transmet ensuite la déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Q : Comment l’agence d’emploi peut-elle aider une entreprise à réduire les accidents routiers ?
R : L’agence peut :
- Organiser des sessions de sensibilisation à la sécurité routière pour tous les intérimaires.
- Réaliser un audit des déplacements professionnels (analyse des itinéraires, état de la flotte, horaires à risque).
- Conseiller sur la mise en place d’un plan de mobilité : covoiturage, horaires décalés, véhicules connectés.
Ces actions améliorent la politique de prévention de l’entreprise et limitent les accidents routiers, renforçant ainsi sa marque employeur.